
La Jason Foundation est une organisation américaine à but non lucratif dédiée à la prévention du suicide chez les jeunes. Fondée en 1997 à la suite du décès tragique de Jason Flatt, un adolescent de 16 ans, l’organisation s’efforce de lutter contre ce qu’elle appelle l’« épidémie silencieuse » du suicide des jeunes .
🎯 Mission et approche
La mission de la Jason Foundation est de fournir des programmes éducatifs et de sensibilisation gratuits pour aider les jeunes, les éducateurs, les parents et les travailleurs communautaires à identifier et à assister les jeunes à risque de suicide
Ressources pour les formateurs en prévention du suicide
Pour les formateurs, la Jason Foundation propose une série de modules de développement professionnel en ligne, conçus pour fournir des informations sur la sensibilisation et la prévention du suicide chez les jeunes. Ces modules sont adaptés aux enseignants, entraîneurs, autres membres du personnel scolaire, travailleurs de jeunesse, premiers intervenants, parents d’accueil et tout adulte travaillant avec des jeunes ou souhaitant en savoir plus sur le suicide chez les jeunes.
Chaque module aborde des sujets tels que l’étendue du problème du suicide chez les jeunes, les signes de préoccupation, les facteurs de risque, comment reconnaître les jeunes qui peuvent être en difficulté et comment les approcher pour les aider à trouver des ressources d’assistance. À la fin de chaque module, une opportunité d’imprimer un certificat de réussite est fournie .
Exemple: Les FACTEURS DE RISQUE chez les adlolescents:
« Le suicide ne survient généralement pas de manière soudaine. Un certain nombre de facteurs de stress peuvent contribuer à l’anxiété et au mal-être d’un jeune, augmentant ainsi la possibilité d’une tentative de suicide. Plusieurs de ces facteurs sont décrits ci-dessous.
Dépression, maladie mentale et toxicomanie: L’un des facteurs de risque les plus révélateurs pour les jeunes est la maladie mentale. Les troubles mentaux ou les dépendances sont associés à près de 90 % des suicides. Un jeune sur dix souffre d’une maladie mentale suffisamment grave pour être altérée, mais moins de 20 % d’entre eux reçoivent un traitement. En fait, 60 % des personnes qui se suicident souffrent de dépression. La consommation d’alcool et de drogues – qui obscurcit le jugement, diminue les inhibitions et aggrave la dépression – est associée à 50-67 % des suicides.
Agressivité et bagarres: Des recherches récentes ont mis en évidence un lien entre la violence interpersonnelle et le suicide. Le suicide est associé aux bagarres chez les hommes comme chez les femmes, dans tous les groupes ethniques et chez les jeunes vivant en milieu urbain, suburbain ou rural.
Environnement familial: Au sein du foyer, un manque de cohésion, des niveaux élevés de violence et de conflit, un manque de soutien parental et l’aliénation de la famille et au sein de celle-ci peuvent augmenter le risque de suicide.
Environnement communautaire: Les jeunes fortement exposés à la violence communautaire courent un risque important de comportement autodestructeur. Cela peut se produire lorsqu’un jeune calque son propre comportement sur ce qu’il vit dans la communauté. En outre, de plus en plus de jeunes grandissent sans établir de liens significatifs avec des adultes et ne reçoivent donc pas les conseils dont ils ont besoin pour les aider à faire face à leur vie quotidienne.
Environnement scolaire: Les jeunes qui ont des difficultés en classe, qui ont l’impression que leurs professeurs ne les comprennent pas ou ne se soucient pas d’eux, ou qui ont de mauvaises relations avec leurs pairs sont plus vulnérables au risque de suicide.
Tentatives antérieures: Les jeunes qui ont déjà fait une tentative de suicide risquent d’en faire d’autres. En fait, ils sont huit fois plus susceptibles de faire une autre tentative de suicide que les jeunes qui n’ont jamais tenté de se suicider.
Facteurs culturels: L’évolution des rôles et des attentes des hommes et des femmes, les questions de conformité et d’assimilation, ainsi que les sentiments d’isolement et de victimisation peuvent tous accroître le niveau de stress et la vulnérabilité des individus. En outre, dans certaines cultures (en particulier les cultures asiatiques et du Pacifique), le suicide peut être considéré comme une réponse rationnelle à la honte.
Antécédents familiaux/stress: Des antécédents de maladie mentale et de suicide parmi les membres de la famille immédiate augmentent le risque de suicide chez les jeunes. Les changements dans la structure familiale tels que le décès, le divorce, le remariage, le déménagement dans une nouvelle ville et l’instabilité financière augmentent également le risque.
L’automutilation: Les comportements d’automutilation comprennent les coups de tête, les coupures, les brûlures, les morsures, les effacements et les blessures creusées. Ces comportements sont de plus en plus fréquents chez les jeunes, en particulier chez les jeunes filles. Bien que l’automutilation signale généralement l’apparition de problèmes plus vastes, la raison de ce comportement peut varier de la pression du groupe de pairs à de graves troubles émotionnels. Bien qu’il faille chercher de l’aide pour toute personne qui s’automutile, une réponse appropriée est cruciale. La plupart des comportements d’automutilation n’étant pas des tentatives de suicide, il est important d’être prudent lorsque l’on s’adresse au jeune et de ne pas faire de suppositions.
Crises situationnelles: Environ 40 % des suicides de jeunes sont associés à un événement déclencheur identifiable, comme le décès d’un proche, la perte d’une relation importante, le divorce des parents ou des abus sexuels. En général, ces événements coïncident avec d’autres facteurs de risque.
Troubles de l’alimentation: Bien que les complications médicales liées à la malnutrition soient la principale cause de décès chez les personnes souffrant de troubles de l’alimentation, on pense que le suicide vient juste après. Le comportement suicidaire est élevé chez les personnes souffrant d’anorexie mentale, de boulimie et d’hyperphagie boulimique, les trois troubles alimentaires les plus étudiés.
LGBTQ+: Les jeunes LGBTQ+ ne sont pas exposés à un risque accru de suicide en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, mais plutôt en raison des mauvais traitements et de la stigmatisation dont ils font l’objet dans la société. Au cours de l’année écoulée, 39 % des jeunes LGBTQ+ ont sérieusement envisagé de se suicider, dont 46 % des jeunes transgenres et non binaires. Les taux de suicide sont plus élevés chez les personnes de couleur que chez les Blancs. Plus de 12 % des jeunes LGBTQ+, dont 14 % des personnes transgenres et non binaires et 7 % des jeunes cisgenres, ont tenté de se suicider l’année dernière.Quarante-six pour cent des jeunes âgés de 13 à 17 ans ont envisagé de se suicider et 16 % ont fait une tentative de suicide l’année dernière. Trente-trois pour cent des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans ont envisagé de se suicider et 8 % ont fait une tentative de suicide l’année dernière. Le projet Trevor est la principale organisation à but non lucratif de prévention du suicide et d’intervention en cas de crise pour les jeunes LGBTQ+. Il fournit des informations et un soutien aux jeunes LGBTQ+ 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l’année.
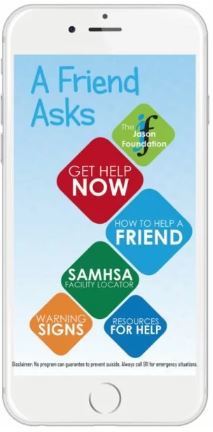
Application « Ask a Friend »
Protocole spécifique de prévention auprès des adolescents
Le protocole de la Jason Foundation repose sur l’éducation et la sensibilisation comme premières étapes de la prévention. L’organisation vise à établir un « Triangle de Prévention » en fournissant aux étudiants, aux parents et aux enseignants les outils et les ressources pour aider à identifier et à assister les jeunes à risque. Cela est accompli grâce à une unité de programme pour les étudiants et des séminaires d’information pour les enseignants et les parents .The Jason Foundation, Inc.
Les programmes de la Jason Foundation sont conçus pour être faciles à utiliser et fournir des informations éducatives. Il n’y a aucune intention de diagnostiquer ou de traiter des idées suicidaires. L’objectif est d’autonomiser les jeunes, les éducateurs et les parents pour les aider à reconnaître quand les jeunes souffrent et savoir comment obtenir l’aide professionnelle le plus tôt possible .
Cadre législatif aux USA: The Jason Flatt Act
La Jason Flatt Act est une législation qui exige que les enseignants et certains membres du personnel scolaire complètent deux heures de formation sur la sensibilisation et la prévention du suicide chez les jeunes pour maintenir ou renouveler leurs qualifications professionnelles. Cette exigence de formation ne s’ajoute pas aux heures de formation déjà requises, mais s’inscrit dans le nombre d’heures déjà nécessaires pour continuer à enseigner. Vingt et un États ont pris l’initiative d’être proactifs dans la prévention du suicide chez les jeunes en adoptant la Jason Flatt Act .
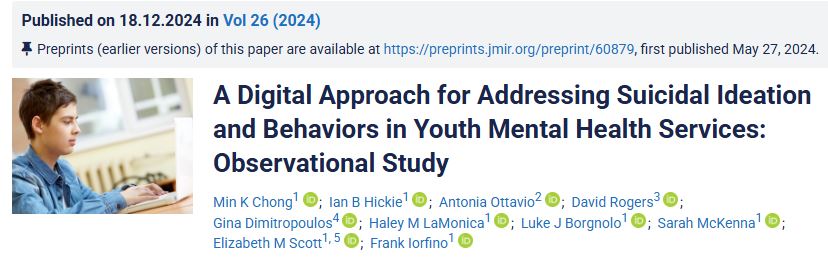


 Il y a deux ans, à Marquette-lez-Lille, Jonathan Destin, aujourd’hui 18 ans, a tenté de se suicider en s’aspergeant d’alcool parce qu’il se disait harcelé au lycée. Il raconte son histoire dans un livre « Condamné à me tuer ».
Il y a deux ans, à Marquette-lez-Lille, Jonathan Destin, aujourd’hui 18 ans, a tenté de se suicider en s’aspergeant d’alcool parce qu’il se disait harcelé au lycée. Il raconte son histoire dans un livre « Condamné à me tuer ». Selon les données du Baromètre santé 2010, 0,9 % des 15-30 ans (0,5 % des hommes et 1,3 % des femmes) ont fait une tentative de suicide au cours des douze derniers mois. Ces données positionnent ainsi cette tranche d’âge comme la plus concernée, en particulier pour les femmes. Cette proportion apparaît relativement stable depuis 2000. À l’échelle de la vie entière, 5,0 % des 15-30 ans (2,7 % des hommes et 7,3 % des femmes) déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide.
Selon les données du Baromètre santé 2010, 0,9 % des 15-30 ans (0,5 % des hommes et 1,3 % des femmes) ont fait une tentative de suicide au cours des douze derniers mois. Ces données positionnent ainsi cette tranche d’âge comme la plus concernée, en particulier pour les femmes. Cette proportion apparaît relativement stable depuis 2000. À l’échelle de la vie entière, 5,0 % des 15-30 ans (2,7 % des hommes et 7,3 % des femmes) déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide.